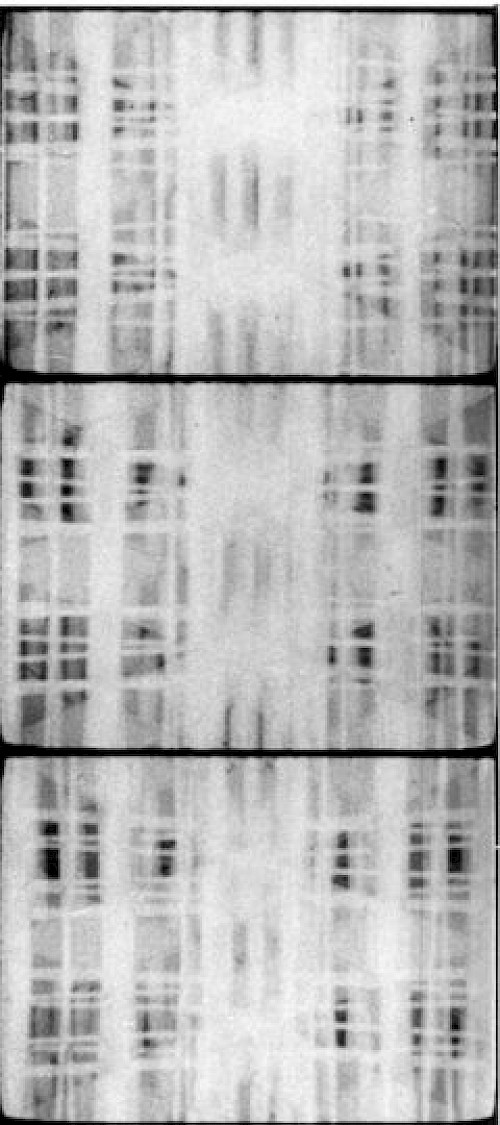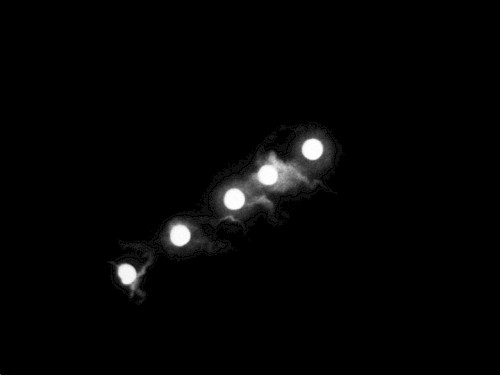« Melba comme un claquement de ruban ». Tels sont les premiers mots d’un article, « Brillance neuronique », qui semble vouloir être comme, sinon un manifeste, du moins une pro-clamation collective des « rédacteurs – fabricants », nous nous nommions ainsi alors, dans le n°1 de la revue initiée par Claudine Eizykman et Guy Fihman1. La formule résume assez bien ce que fut cette aventure Melba, entre éclat et matérialité. Éclat de la forme et matérialité du cinéma. Double revendication du cinéma comme forme et matière, et dislocation/fracturation de la forme dans et par la matière cinéma elle-même : le ruban photogrammique. programmatique, au départ, l’affirmation de la matière film : « Nous faisons du cinéma, nous travaillons donc sur le dispositif cinématographique qui est l’intermittence, la mise en relation de 48 informations par seconde inscrites sur un ruban, pulsées par 24 jets de lumière sur un écran. C’est ici que le cinéma commence2 ».
C’est ici que le cinéma commence. Entre le ruban et l’écran. Un départ entre le support filmographique et sa projection écranique (comme deux états du « cinéma »), entre les photogrammes (la série photogrammique), entre les images et les graphes, le photographique et le plastique, la fixité et la mobilité, le rythme et la variation. Mais un autre départ est possible. Géographique, institutionnel (ou plutôt associatif, coopératif). À l’université de Vincennes, où professaient donc Claudine Eizykman et Guy Fihman, puis autour de la Paris Films Coop et de la revue Melba. Vincennes, où se retrouvaient étudiants, ou non étudiants, déjà artistes, déjà cinéastes, dans une effervescence à la fois théorique et pratique (comme on disait à l’époque), créatrice. Alors qu’au Centre Saint-Charles (de l’Université Paris Panthéon Sorbonne), Dominique Noguez promouvait une autre voie du « cinéma expérimental », principalement axée autour de la question du corps. Cinéma du corps, corps du cinéma selon sa propre expression, dont les principaux artistes étaient Stéphane Marti, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Téo Hernandez, Michel Nedjar, Jakobois),… c’est donc autour de ces trois pôles (Vincennes/Paris Films Coop/Melba (auxquels il faudrait ajouter le Ciné Club de la Maison des Beaux-Arts (ciné MbXa) animé par Dominique Willoughby où furent montrés les films in progress, ainsi que le cinéma historique et les artistes et mouvements étrangers), que s’est constituée ce qui ne fut pas une « école » ni même un « mouvement » au sens où l’entend l’histoire de l’art, mais une constellation de recherches, rassemblées par l’attractivité énergisante de Vincennes et une même approche du matériau cinéma, chacun s’affirmant dans la singularité de sa méthode, de ses dis- positifs, des ses objets propres3. Chacun expérimentant.
Mais outre le départ du dispositif, ou de la dimension générationnelle, une autre piste s’ouvre : l’histoire du cinéma avant-garde / expérimental lui-même. Dans la perspective qui est la nôtre deux grands moments se présentent : l’avant-garde plastique ou du cinéma pur des années 1920 en Europe, et l’école dite « structurelle » des années 1960 aux États-Unis. Une distinction massive définirait les années 1920 comme la grande affirmation du mouvement, du rythme, de la continuité.
Des peintres, comme Survage, Eggeling ou Richter, cherchant une dimension temporelle, rythmée, en mouvement de la peinture, aux cinéastes du cinéma pur (Germaine Dulac, Henri Chomette) ou de la photogénie (Epstein), le cinéma est alors la grande force de l’universelle fluidité du monde4. À partir des années 1950, sous l’impulsion de la réflexion et des films de Peter Kubelka du cinéma comme « non mouvement » (où le mouvement écranique continu ne serait quʼun cas particulier du cinéma), va émerger une tendance définie par le critique américain P. Adams Sitney comme « cinéma structurel5 » (de cette tendance Sitney cite Michael Snow, Paul Sharits, Ernie Gehr, Tony Conrad, Hollis Frampton, Joyce Wieland et il souligne l’importance d’Andy Warhol. il distingue ce cinéma du « film lyrique », celui d’une Maya Deren ou d’un Stan Brakhage.) ; les quatre caractéristiques en sont : le plan fixe, l’effet de clignotement, le tirage en boucle et le refilmage de l’écran. Un cinéma « fondé sur la structure dans lequel la forme d’ensemble, prédéterminée et simplifiée, constitue l’impression principale produite par le film ». Un cinéma minimaliste. « L’école de Vincennes » a souvent été qualifiée de cinéma « post structurel ». Elle le fut pour une part, dans sa position vis-à-vis de la continuité/mou- vement des années 1920, et par le fait de définir le cinéma, à la suite de Kubelka, comme, « articulation », et discontinuité/mobilité (Marey plutôt que Lumière, Man Ray plutôt que Chomette6).
Mais d’une autre façon on peut aussi dire qu’il ne s’agit pas seulement d’une suite du cinéma structurel, mais aussi bien, par-dessus les années 1950 et 1960, d’un dialogue renoué, proche et distancié, avec les années 19207. À la simplicité structurelle minimaliste, l’école de Vincennes a répondu par un travail partant des constituants préformés de la structure : cadre, photogramme, répétition, mouvement de caméra,… pour en faire une nouvelle matière, la « matière cinéma », repliant les éléments sur eux-mêmes, les croisant, les superposant. Retrouvant même les questions des années 1920 : le rythme, les rapports plastiques et rythmiques, peinture et mouvement ; pour les mêler aux problématiques du structurel : immobilité/mobilité, couleur/mouvement. Ainsi les deux films phares de cette tendance, Vitesses Women (1974) de Claudine Eizykman et son travail d’entremêlement/superposition de courtes séquences photogrammiques, Ultra Rouge Infra Violet (1974) de Guy Fihman, constitué de mouvements intensifs sur place, de variations colorées continues.
Ainsi du travail, pour nous en tenir aux cinéastes de la programmation, de Christian Lebrat sur l’agencement de bandes colorées dans le cadre de l’écran produisant et des effets d’enchaînement et des effets de surimpression ; de Jean-Michel Bouhours et sa construction de rythmes par la composition de « tableaux » fixes ; de Dominique Willoughby et sa mise en relation d’images cinéma continues et d’actions graphiques et peintes sur la pellicule, réalisant à la lettre le cinémato-graphique ; de Pascal Auger et son intérêt pour les jeux répétitifs d’images s’engageant lui aussi dans des rythmes qui sont autant du cinéma que du monde. Il s’agit de cela : faire interagir les « éléments » et du monde et du cinéma, pour qu’ils s’entrechoquent, s’ouvrent et dégagent leur maximum d’intensité. Et par delà les éléments/constituants et par leur interaction, on rejoint, alors déplacées, les questions des années 1920 et leur réflexion sur les relations du cinéma avec la photo, la peinture, la musique. Et le monde8.
Car là est bien le propre de ce cinéma : superposer, mêler, les forces et les matières, du monde (que les années 1920 affirmèrent par le cinéma9) et du cinéma lui-même (que le structurel fit émerger), pour en un « claquement de ruban » faire vibrer et monde et cinéma dans leur fracturation explosante. On pourrait alors paraphraser Dulac : un art fait du cinéma, s’en évade en faisant corps avec lui. La suite de l’histoire du monde image/réseaux montra que ce cinéma avait vu, prévu, juste.
— Prosper Hillairet